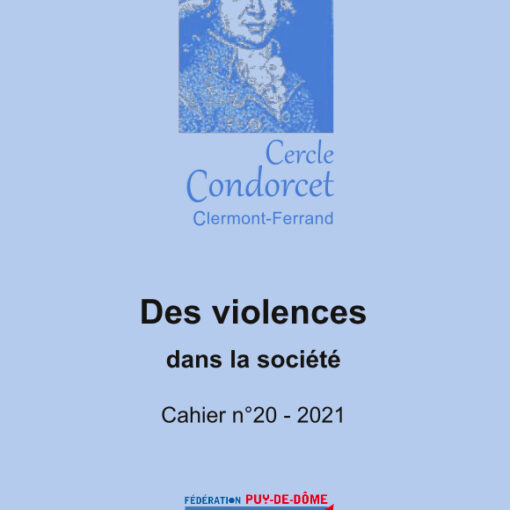Le siècle des lumières (fin XVIIIème siècle) et son influence
Condorcet (1743-1794) est connu pour ses réflexion sur le droit et la peine de mort et sa passion pour l’éducation. Dans sa Théorie de l’égalité des sexes, il écrivait : « songez, messieurs qu’il s’agit des droits de la moitié du genre humain ».
Sous l’influence des philosophes et de encyclopédistes, au XVIIIème siècle les salons féminins se multiplient en France (Mme de Pompadour, Mme du Tencin, Mme de Staël) ils permettent aux femmes « éclairées », c’est-à-dire instruites, de jouer un rôle culturel, social voire politique et sont d’ailleurs plus admirés à l’étranger qu’en France même.
Les hommes y sont admis et les hôtesses brillent par leur fortune et par leurs relations dans le monde des arts et des lettres. Les historiens contemporains considèrent les salons comme un lieu d’émergence des idées révolutionnaires, même si on n’accorde pas à ces femmes de crédit politique.
Le tournant du XIXème siècle
Cependant, l’instruction même minime ne touche qu’une infime partie des femmes, à la fin du XVIIème siècle : seules 14% savent signer leur nom et 27% à la fin du XVIIIème !
La famille Bonaparte fait instruire ses garçons et ses filles, mais le jeune et ambitieux général Bonaparte confie l’instruction de sa fille Caroline à « l’institution nationale Saint germain », une maison d’éducation montée pour les fillettes des dignitaires du directoire et du consulat.La « maison « était tenue par Mme Campan (1752-1822) ancienne lectrice des filles de Louis XVI. Elle officia pendant une dizaine d’années pour élever les jeunes filles en demoiselles « distinguées : danse, peinture, lectures mais aussi rudiments de sciences et langues vivantes elle parlait elle-même couramment anglais et espagnol et avait des notions d’italien.
Quant à la maison d’éducation que fut « l’institution des demoiselles de la légion d’honneur », créée par Napoléon en décembre 1805, elle ne fut jamais supprimée. Elle était destinée aux jeunes filles de 7 à 21 ans, pauvres ou orphelines dont les parents étaient porteurs de la Légion d’honneur, elle faisait suite à la Maison royale Saint Louis ouverte par Mme de Maintenon.
Ouverts par Napoléon en 1802, les lycées – peu nombreux – restent fermés aux femmes ; ils correspondent à une vision sexuée de la société pendant toute une partie du XIXème siècle et au début du XXème siècle.
Les écoles protestantes ont leurs écoles pour filles, et Jules Ferry s’inspirera de leurs programmes pour élaborer ses réformes scolaires.
Quelques avancées
L’ouverture de l’enseignement primaire aux filles par la loi Falloux de 1850 qui institue une école primaire filles par département, et surtout les lois Ferry sur l’école laïque, gratuite et obligatoire de 1882, ouvriront largement la possibilité d’études pour les filles ne serait-ce que par la voie de l’enseignement « primaire supérieur ».
L’accès des femmes à l’enseignement secondaire est dû aussi à l’obstination de Camille Sée (1847-1919) qui créa la possibilité de l’enseignement secondaire avec les collèges et lycées publics pour jeunes filles en 1880 ; il ira même plus loin en créant l’École Normale Supérieure de Sèvres le 29 juillet 1881 dont la première directrice sera la veuve de Jules Favre ; elle voulait former laïquement les femmes professeurs. En dépit de l’action de Camille Sée, l’accès au bac reste difficile, on lui préfère le CES (certificat d’études secondaires avec une épreuve de gymnastique et de couture et sans latin et grec). Pourtant des lycées pour jeunes filles s’ouvrent, ils resteront payants jusqu’en 1933 : le premier à Montpellier dès 1882 ; en 1893 il y en aura 13, le lycée Jeanne d’Arc de Clermont date de 1899.La proportion des filles passant le bac est très inférieure à celle des garçons en 1930 il n’y aura encore que 3 garçons pour 1 fille. Le concours général leur est ouvert en 1919 mais il faut attendre 1930 pour que la première femme y soit lauréate : c’est Jacqueline David que l’on connaît sous son nom de femme Jacqueline de Romilly.
La mixité obligatoire dans les lycées se fera dans la foulée de 1968, par une loi de 1975. De nos jours on peut dire que la mixité existe dans les baccalauréats généraux où les filles plus sérieuses réussissent mieux que les garçons : 90% contre 86%.
1893 État de la situation des écoles de filles dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand par l’inspection académique. La propagation de l’instruction primaire dans nos campagnes sera un des plus puissants moyens de moralisation et de bien-être. C’est surtout par l’éducation de la femme qu’on fera naître et qu’on développera avec le sentiment religieux dans les familles (on est avant la loi de 1905 de séparation de l’Église et de l’État) et en société ces habitudes d’ordre, de travail et d’économie en assurent le bonheur et la prospérité ».
Les pionnières
Les premières bachelières obtiennent pourtant leur diplôme sous le Second Empire. Les « féministes » s’entêtent et en 1892 il y aura 12 bachelières. Il faudra toutefois attendre 1924 pour que les programmes du bac soient identiques pour les garçons et les filles à l’initiative du ministre Léon Bérard.
Le bac est un des facteurs de l’émancipation féminine ; beaucoup de jeunes femmes au début du XXe siècle entreront dans l’enseignement surtout primaire, dans le secondaire le mouvement sera plus tardif ; les femmes comme les hommes qui ne sont pas agrégés doivent suivre tout un parcours après la licence de répétiteur à professeur.
Victoire enfin
Le XIXe siècle comme les autres siècles n’est pas indulgent avec les femmes. Jules Ferry dans son traité de l’éducation de 1870 refusait le principe d’égalité et « réservait » la femme à l’éducation des enfants.
Un chansonnier à la mode Paul Delvaux (1825-1867) dans son dictionnaire de la langue verte se moque ouvertement de la bachelière et une chanson populaire de Paul Burani trace, dans « Mamzell’ Flora », un portrait particulièrement trivial et particulièrement salace de la bachelière.
La première femme bachelière fut une lyonnaise Marie Daubié le 16 août 1861, une institutrice de 36 ans (voir dossier précédent). Le ministre de l’Instruction publique Victor Duruy, qui ouvrira pourtant en 1867 l’enseignement primaire aux filles et le premier lycée féminin dès 1863 refusera alors de signer le diplôme ne voulant pas se ridiculiser. Il fallut l’intervention de l’impératrice Eugénie en personne pour qu’il cède. Gagnant aussi les rangs de l’université et avec une licence en Sorbonne obtenue en 1891 Victoire Daubié devint journaliste internationale.
A l’université : une ascension difficile
Les pionnières dont l’exemple et les femmes bachelières deviendront de plus en plus nombreuses. Mais elles ne se contentent pas de ce seul diplôme et réussissent à conquérir aussi l’université. Les débuts de cette nouvelle promotion sont difficiles car les hommes renoncent difficilement à leur suprématie.
« L’étudiante » est une figure nouvelle et contestée sous la IIIème République. Après la difficile obtention du Bac sous le Second Empire, quelques rares universités s’ouvrent aux femmes en province comme à Lyon dès 1863 ; Paris fait de la « résistance » et la Sorbonne ne s’ouvre aux filles qu’en 1866. Emma Chenu, la deuxième femme bachelière n’y entre en 1867 ! Il faut attendre 1879 pour une première inscription en lettres sans conditions, 1894 en droit et 1893 en pharmacie. Le nombre des jeunes filles est si faible qu’elles ne sont mentionnées dans les statistiques de l’Instruction publique qu’après 1890 soit 3% des étudiants en 1900, 12% en 1910, 28% en 1935. Parmi elles, beaucoup d’étrangères, surtout des Juives chassées par les progroms d’Europe centrale.
Les raisons de cet ostracisme sont nombreuses, mais liées principalement à la misogynie ambiante. On dit d’abord « étudiante-fille » car à l’époque l’étudiante est la « grisette » qui couche avec un étudiant ! On dit aussi avec un aspect péjoratif « l’intellectuelle bas bleu », pire « la cerveline » parce qu’elle veut comparer son cerveau à celui de l’homme. On les accuse d’érotisme pernicieux parce qu’elles se parfument, de chercher un mari, on leur conseille des tenues prudes, Un huissier leur ferme la porte si elles n’ont pas une autorisation du ministère qui leur est accordée à condition d’avoir un chaperon mère ou mari, c’est les cas de la première étudiante en droit Mlle Bilbescu. Elles subissent des brimades : jets divers dans l’amphi, ou refus du professeur de travailler en leur présence.
L’obstination des femmes cependant l’emporte sur les préjugés et les obstacles. Les progrès de la scolarisation leur permettent de trouver leur place dans les structures qu’on voudrait leur interdire, la recherche ou l’université. Elles accèdent peu à peu à un rôle politique et dès le siège de Paris en 1870-71 Les femmes sont consultées. Victoire Daubié et Emma Chenu siègent toutes deux dans une commission sur l’enseignement présidée par le savant Arago et Jules Ferry, elles remettront un rapport qui influencera surtout l’enseignement primaire.
La contribution des femmes à la Commune est notoirement reconnue ; elles sont militantes, révolutionnaires, mais aussi victimes des représailles et des exécutions sommaires. Moins connue que Louise Michel mais titulaire comme elle du « brevet de capacité de maîtresse », Marguerite Victoire Tinayre est une issoirienne insoumise qui monte à Paris rejoindre l’insurrection.