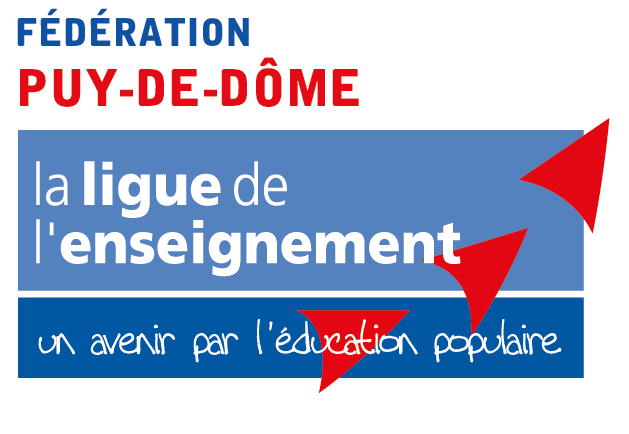Le siècle des lumières (fin XVIIIème siècle) et son influence Condorcet (1743-1794) est connu pour ses réflexion sur le droit et la peine de mort et sa passion pour l’éducation. Dans sa Théorie de l’égalité des sexes, il écrivait : « songez, messieurs qu’il s’agit des droits de la moitié du genre humain ». Sous l’influence des philosophes et de encyclopédistes, au XVIIIème siècle les salons féminins se multiplient en France (Mme de Pompadour, Mme du Tencin, Mme de Staël) ils permettent aux femmes « éclairées », c'est-à-dire instruites, de jouer un rôle culturel, social voire politique et sont d’ailleurs plus admirés à l’étranger qu’en France même.
dossier
Lorsqu'on assiste au spectacle émouvant de toutes ces jeunes filles pleurant de joie à l'annonce de leur succès au baccalauréat, on n'imagine pas que le diplôme de bachelière leur a été longtemps refusé et qu'elles ont été exclues de toutes les réformes scolaires qui ont marqué la fin du 19è siècle, voire le début du 20è. C'est ainsi qu'il faut attendre 53 ans après la création du bac en 1808 pour qu'un ministre de l'éducation accepte de signer le diplôme de la première Bachelière, Marie Daubié. En 1892, on ne compte que 12 bachelières, et il faut attendre 1945 pour que les lauréates cessent d'être l'objet d'un mépris qui s'exprime sous la forme de quolibets et de moqueries.
L'émancipation des femmes gagne du terrain et beaucoup de jeunes femmes au début du XXème siècle entreront dans l’enseignement surtout primaire ; dans le secondaire le mouvement sera plus tardif. Les premières femmes agrégées sont respectivement en 1912 Jeanne Raison en grammaire et en 1913 Marguerite Rouvière en sciences physiques et sortent de Normale Supérieure de Sèvres.
Elles seront nombreuses, ces femmes diplômées, à devoir se battre pour être reconnues, et acceptées dans le monde des hommes. C'est ainsi que Madeleine Pelletier (1874-1939), première femme diplômée en psychiatrie, se coupe les cheveux et s’habille en homme pour se « fondre dans un service ».
Reconnaissance
Toutefois l’une d’entre elles fait l’unanimité Marie Curie (1867-1934), physicienne, chimiste, naturalisée française par son mariage. Elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel en 1903 avec son mari et Becquerel, puis la seule femme à ce jour a en avoir 2, l’autre reçu en 1911. Après une brillante carrière universitaire, à partir de 1906 après la mort de son mari, elle est la première femme directrice d’un laboratoire où l’on recrute selon la compétence et non le sexe, la première femme professeur à la Sorbonne où son discours inaugural inquiète les journaux « la femme peut-elle dominer l’homme par sons savoir ? ». Pendant la première guerre mondiale, après avoir passé son permis de conduire, elle parcourt le front avec « ses 18 petites curies » unités radiographiques ! Elle a cet autre privilège de faire partie des rares conductrices.
Le bac, premier grade universitaire, est donc institué par décret du 17 mars 1808 ; Napoléon avait créé l’université en 1806, mais elle ne sera vraiment organisée et prête à fonctionner que deux ans plus tard le 17 mars 1808. A la demande de l'Empereur, qui souhaitait la création de diplômes universitaires, le chimiste François Fourcroy (1755-1809), un « technocrate » proche de Condorcet, préconisa le baccalauréat
Pendant plusieurs siècles, une conception sexiste – autant que simpliste – réduit les femmes – et cela depuis l'origine de l'humanité – au rôle prépondérant de la femme au foyer : véritable métaphore qui nous renvoie à des mœurs quasiment tribales. Elles sont sous le joug d’un chef « paterfamilias », seigneur ou mari. Les juristes, les penseurs approuvent cela, dans l’antiquité « leur faiblesse d’esprit légitime leur incapacité juridique» ; et les docteurs de l’église comme Saint Thomas d’Aquin la juge « incapable de tenir une position juridique » Jules Ferry lui-même, pourtant partisan de « l'école de filles » cantonnait les femmes à leur mission domestique, et même patriotique en fonction des tourmentes de l'histoire.
Dossier constitué par Alain Bandiéra d’après les textes de Françoise Fernandez, professeure d’histoire, février 2020 Le 12 juillet 2018, la dépouille de Simone Veil entrait au Panthéon accompagnée de celle de son mari Antoine. Trois ans plus tôt, le 27 mai 2015 pour la première fois, deux hommes et deux femmes étaient entrés ensemble au Panthéon en même temps que Pierre Brossolette et Jean Zay. Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle rejoignaient ainsi Marie Curie et Sophie Berthelot, qui les […]
A l’occasion de l’anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, la FAL propose aux écoles, collèges, associations, municipalités, une exposition de 50 photos réalisées en ombres chinoises par le Collectif Images Auvergne, illustrant les droits, ainsi que des documents d’accompagnement. L’exposition peut-être tout aussi bien un support pour un travail pédagogique en classe, ou un outil de communication et promotion pour ces droits non encore respectés en de nombreux endroits du Monde. Les photos, réalisées en 2 formats […]
L’Amicale laïque de Billom a soutenu le projet d’une exposition consacrée aux monuments aux morts, exposition présentée au public en novembre 1918, destinée à la réhabilitation et apportant sa pierre à l’édification de la paix. Christian Guy pour les photos, et Annette Guillaumin pour les textes ont conçu et réalisé ce formidable travail de mémoire. Extrait du discours d’inauguration par Annette Guillaumin : Les images Nous sommes quasiment toutes et tous des descendantes et descendants de familles qui ont vécu, subi, […]